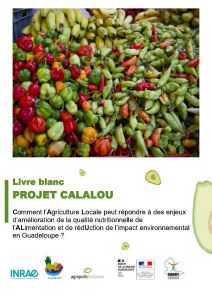En Guadeloupe, le secteur agricole est très spécialisé dans les cultures d’exportation (canne, banane) et l’offre locale en produits destinés au marché intérieur ne couvre pas la demande. Le territoire est fortement dépendant des importations : autour de 40 % des calories sont importées sous forme de graisses et de glucides, 15% sous forme de protéines. Parallèlement, diverses études ont mis en évidence des problèmes de santé publique liés à l’alimentation, tels qu’une prévalence élevée de l’obésité (23 % de la population), du diabète et de l’hypertension.
Comprendre et évaluer les possibilités de réponse de la production agricole locale à un objectif d’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’alimentation en foyer et en restauration scolaire des populations en Guadeloupe représente un enjeu majeur. C’est autour de cet enjeu que se focalise le consortium pluridisciplinaire CALALOU qui rassemble 6 partenaires intégrés à 4 départements de recherche INRAE et deux partenaires locaux. Ce projet repose sur une approche interdisciplinaire qui allie sciences sociales (économie, géographie), sciences de la nutrition, agronomie, et sciences environnementales.
Les chercheurs ont étudié les préférences alimentaires des consommateurs, la structure de la production agricole locale, évalué l’acceptabilité de ces changements auprès des acteurs du système alimentaire et mesuré les impacts environnementaux d'une possible relocalisation de l'alimentation. Ces travaux conjuguent des études sur le terrain, des analyses quantitatives et qualitatives, et des échanges avec des partenaires locaux. Ce projet a intégré trois échelles d’analyse du système alimentaire guadeloupéen : les consommateurs, la restauration scolaire et le territoire.
Télécharger le livre blanc :
Est-il possible d’améliorer la qualité de l’alimentation à partir de l’offre locale ?
En Guadeloupe, les prix des aliments sont en moyenne 30 % plus élevés qu’en Hexagone. Les chercheurs ont construit une base de données de prix alimentaires qui leur a permis de réaliser des exercices de modélisation de diète. Les résultats des scénarios montrent qu’il serait théoriquement possible d’améliorer la qualité de la diète guadeloupéenne sans grever le budget en réduisant la quantité de boissons sucrées, en augmentant la quantité de féculents non raffinés locaux (racines et tubercules, légumes secs) par rapport aux féculents raffinés importés (pain, pâtes, riz), en augmentant la consommation de fruits et légumes frais et en substituant les poissons et les œufs à la viande. Ces changements alimentaires permettraient théoriquement de relocaliser 75 % de la diète moyenne. Toutefois, ces résultats impliqueraient des changements d’alimentation drastiques, notamment chez les jeunes qui ont abandonné le régime traditionnel.
Une expérience économique sur différentes semoules (blé, kamanioc, fruit à pain) montre que les consommateurs sont sensibles à la dimension locale des produits surtout si ces produits sont faciles à utiliser. Les consommateurs apprécieraient des transformations alimentaires qui faciliteraient la préparation des produits locaux (notamment des tubercules jugés difficiles à préparer).
Simplifier l’usage de certains produits perçus comme difficiles à préparer, comme les tubercules locaux, pourrait faciliter leur intégration dans les habitudes alimentaires
Comment les produits locaux peuvent-ils améliorer la durabilité des repas servis en restauration scolaire ?
Pour répondre à cette question les chercheurs ont d’abord collecté des données auprès de 27 structures de restauration scolaire des écoles élémentaires. Ils ont compilé les menus servis, les fiches recettes des plats servis et relevé les prix d’achat des aliments par les structures. Sur les 332 aliments constituant les menus, 101 étaient considérés comme locaux tandis que 231 étaient importés. Les chercheurs ont ensuite cherché à construire des séries de menus optimales qui permettent de maximiser la quantité de produits locaux servis tout en tenant compte des contraintes nutritionnelles, des impacts environnementaux, du coût et de la diversité des plats. Ils ont montré qu’il était possible d’augmenter la part de produits locaux jusqu’à 77 % dans les menus tout en respectant ces contraintes. Ils ont également pu identifier une liste d’aliments à privilégier pour atteindre cet objectif : les carottes et les courgettes, l’ananas et le pamplemousse, les haricots secs, les ignames et le poulet.
Toutefois, compte tenu de l’offre actuelle, augmenter la part de produits locaux se ferait au détriment de la diversité des plats servis en cantine. Il serait donc nécessaire de développer certaines filières végétales et animales pour tendre vers des séries de menus optimales, et diversifiées.
Des initiatives telles que la simplification des appels d’offres, la formation des agriculteurs et une sensibilisation accrue des élus pourraient faciliter l’intégration des produits locaux dans les cantines scolaires.
Peut-on relocaliser la production maraîchère pour approvisionner les cantines scolaires en Guadeloupe ?
Du côté de l’approvisionnement des restaurants scolaires, les structures agricoles existantes seraient en mesure d’approvisionner les cantines scolaires mais certaines conditions ne sont pas remplies. La contractualisation des commandes permettrait d’améliorer la planification. La sécurisation des paiements encouragerait les agriculteurs locaux, tout comme la facilitation de réponse aux appels d’offre. Enfin, une meilleure logistique (transport, stockage) doit être mise en place.
A quelles conditions et pour quels impacts une relocalisation de la production alimentaire serait-elle possible ?
L’évaluation environnementale de l’alimentation guadeloupéenne montre que l’impact en termes d’émissions de GES est similaire à celui de l’Hexagone. Les principaux impacts d’une relocalisation de l’alimentation en Guadeloupe proviendraient de l’utilisation d’engrais et de l’usage des terres due à l’extension de l’élevage. Une solution pour limiter les impacts liés à la relocalisation de l’alimentation serait de végétaliser la diète et l’adoption de nouvelles pratiques agricoles moins impactantes (agroforesterie, utilisation d’amendements organiques, etc.).
Quant au secteur agricole, une relocalisation marquée de l’alimentation (+ 50 %) serait possible à ressources constantes (sans augmentation de la SAU et de la main d’œuvre agricole), mais à condition de mobiliser des surfaces actuellement occupées par de la canne à sucre et de la main d’œuvre principalement employée dans la production de banane. Cela permettrait de développer la production maraîchère et vivrière et l’élevage extensif de ruminants sur savanes (prairies permanentes). Ainsi, les principaux défis à relever pour la relocalisation de la production alimentaire sont la reconquête de foncier agricole, l’augmentation des rendements agronomiques, la formation de main d’œuvre agricole qualifiée et l’attractivité du secteur agricole en terme d’emploi. Les surfaces contaminées à la chlordécone sont une contrainte à cette relocalisation, car limitant fortement les possibilités d’élevage et de production de tubercules sur ces sols.
Le projet CALALOU ouvre ainsi des perspectives pour repenser la relation entre alimentation et territoire, tout en plaçant la santé des populations et celle de l’environnement au cœur des priorités. Cette démarche, en impliquant activement les acteurs locaux et en répondant aux freins identifiés, jette les bases d’une transition alimentaire durable et adaptée aux spécificités du territoire.
"Ce livre blanc se veut une invitation à la réflexion et à l'action. Il propose des éléments de réponse aux défis alimentaires contemporains, non seulement en Guadeloupe, mais aussi pour d’autres territoires aux problématiques similaires. Nous espérons que cette contribution puisse inspirer d'autres initiatives et ouvrir de nouvelles voies de recherche autour de la production alimentaire locale et durable."
Sophie Drogué, coordinatrice du projet
Les partenaires du projet
Ce projet a été financé par le métaprogramme INRAE SYALSA et la Fondation Agropolis.
Le métaprogramme SYALSA a pour objectif d’identifier et évaluer les leviers d’action susceptibles de rendre les systèmes alimentaires plus favorables à la santé humaine, à travers l’alimentation et leurs effets sur l’environnement, en prenant en compte les co-bénéfices entre santé et environnement.